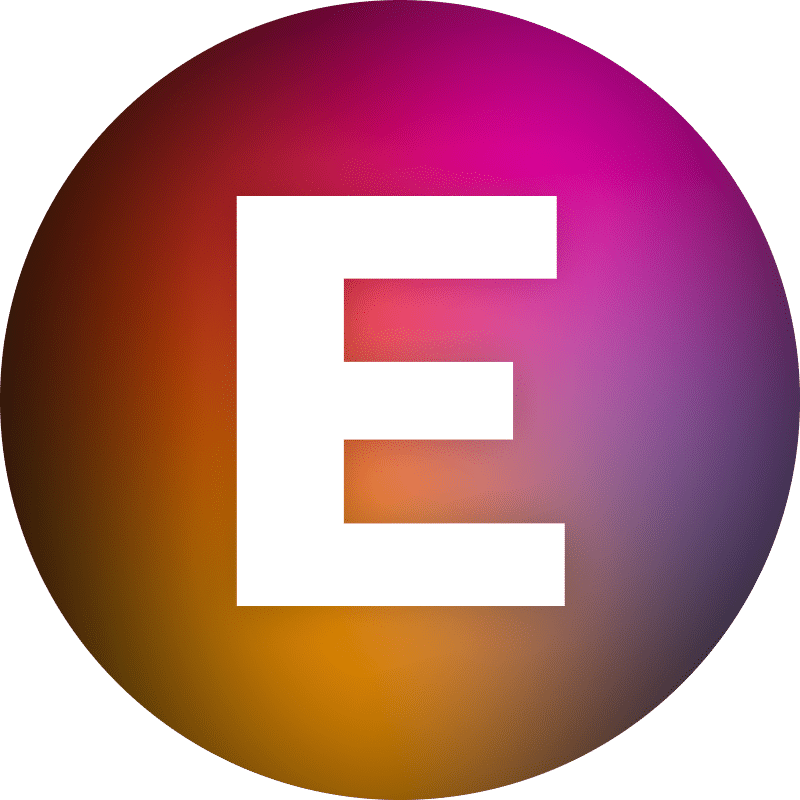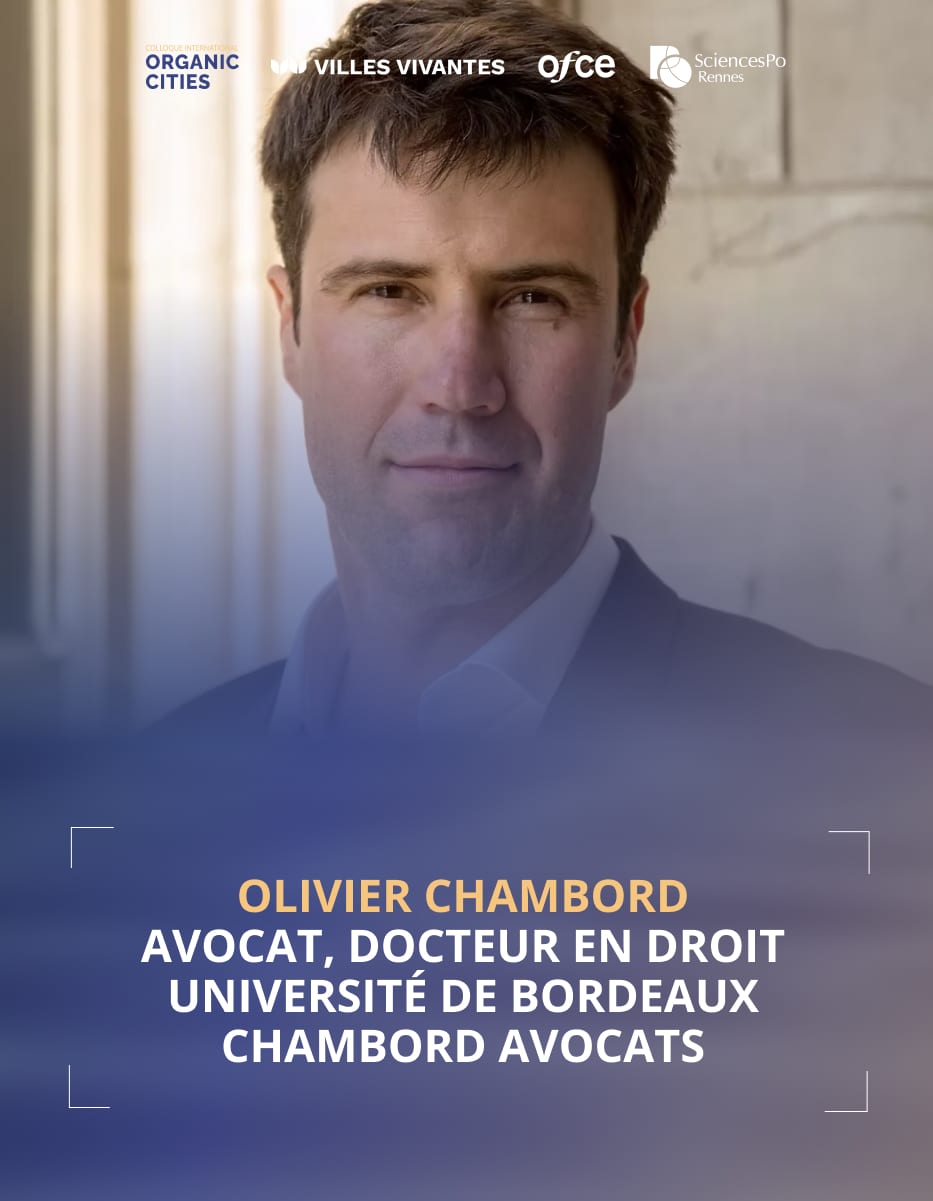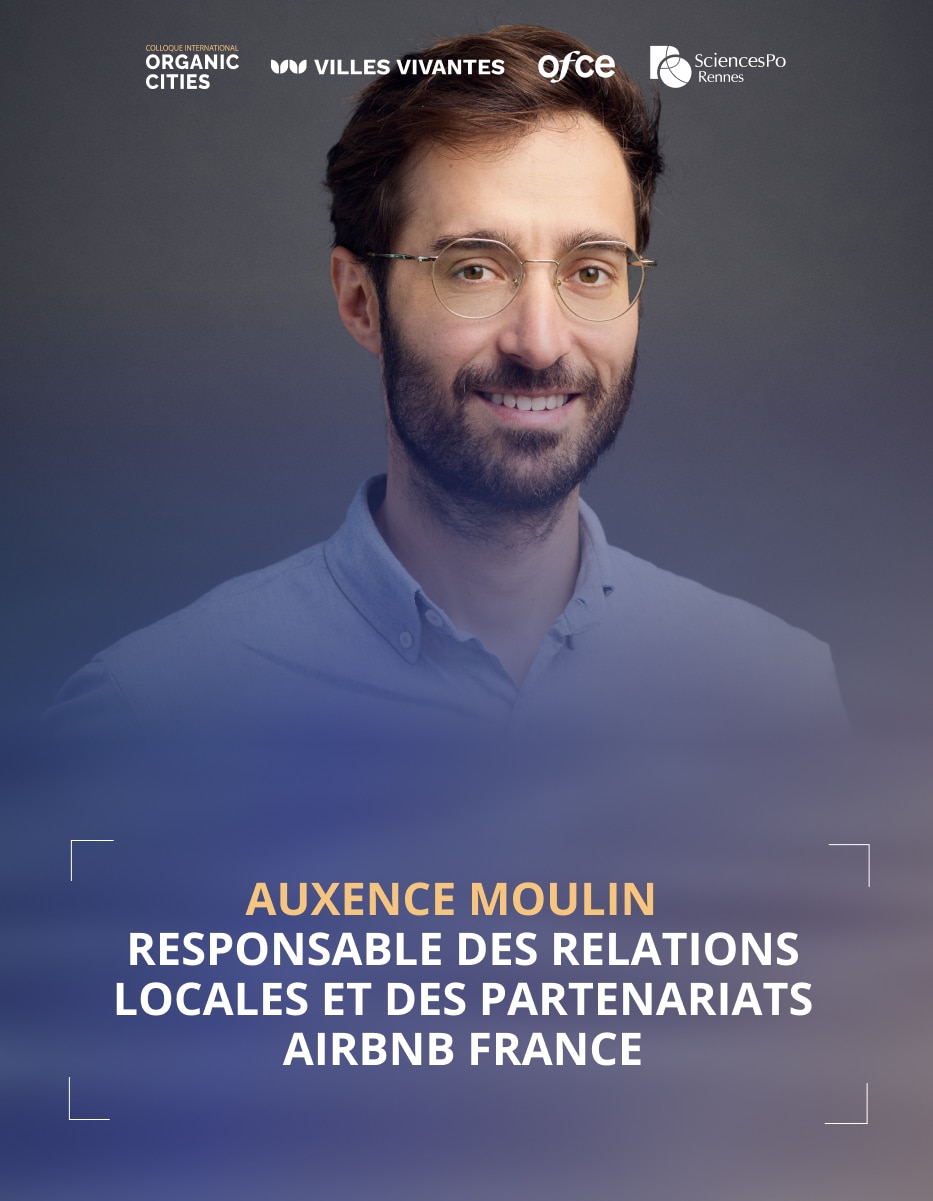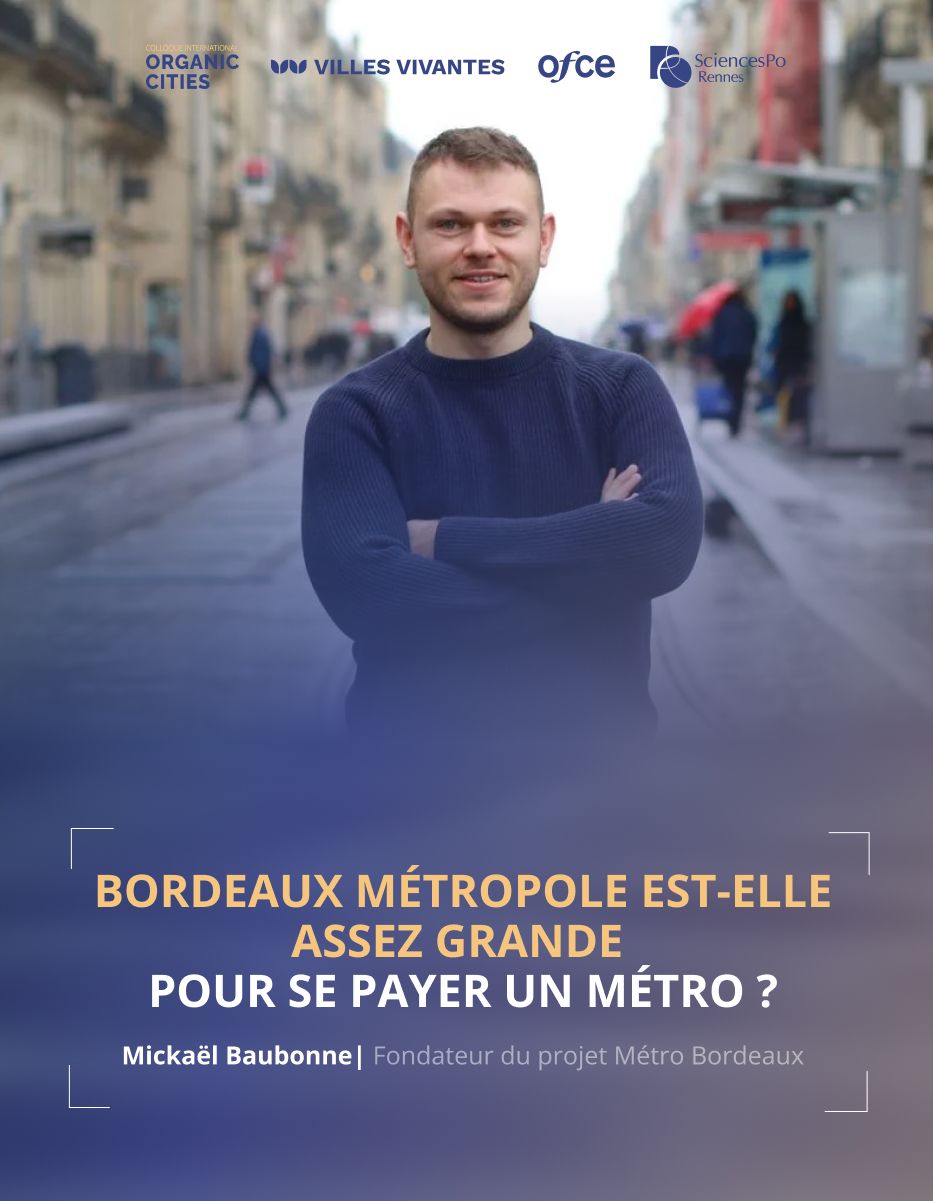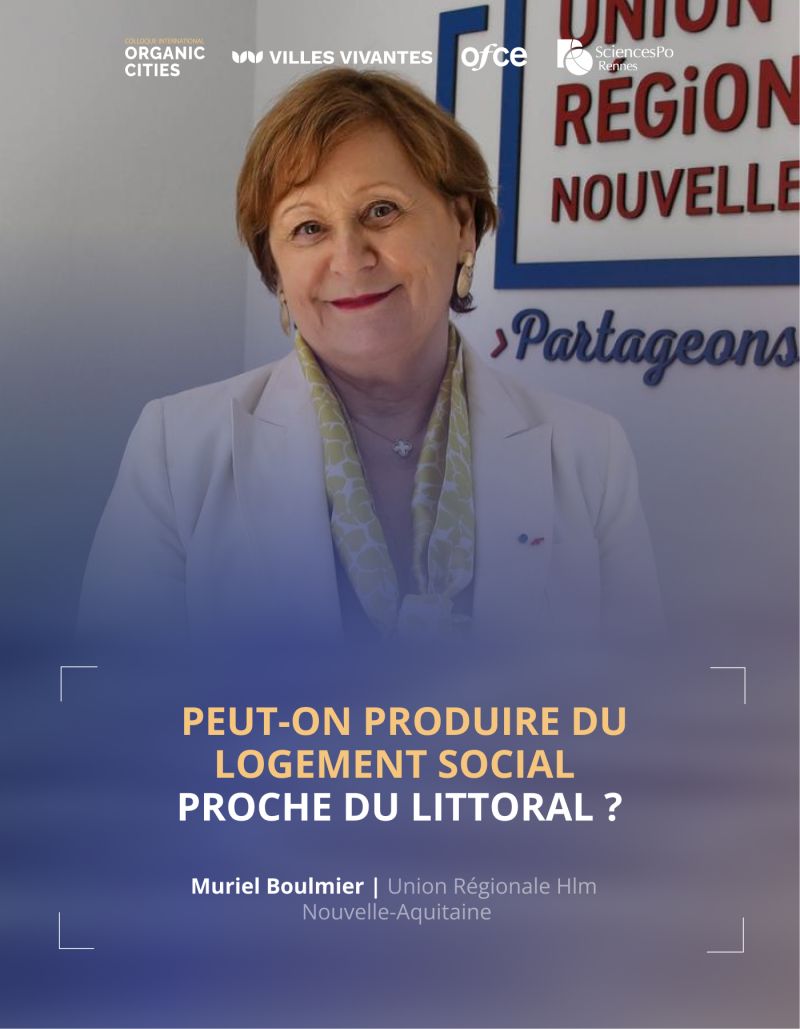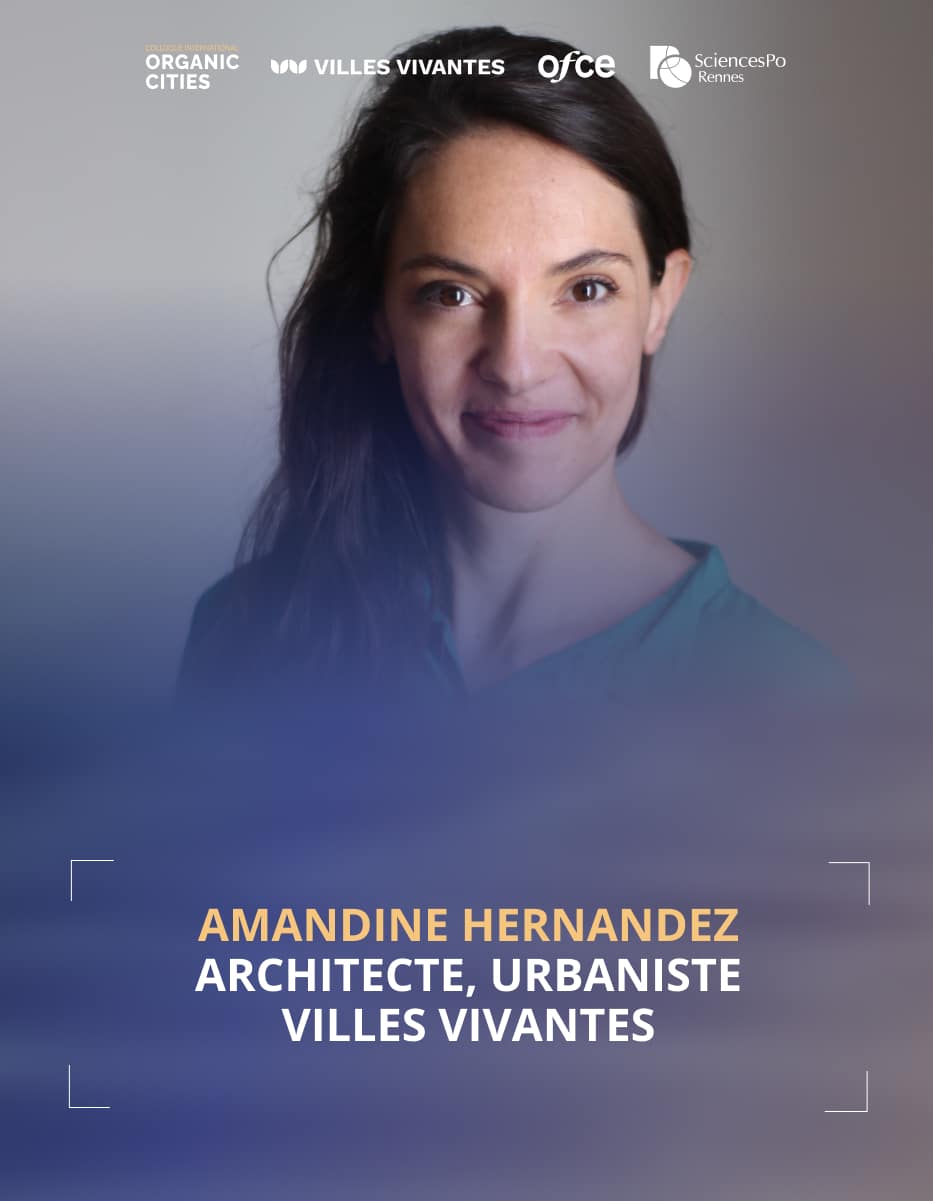ORGANIC CITIES II – FRENCH WEST COAST
les 18 & 19 septembre 2025 à Sciences Po Rennes !
Après La Grande Motte et son retour en grâce inattendu, c’est un autre registre de beauté architecturale qui fait l’objet d’un regain d’intérêt : celui du style basque.
Après des décennies d’oubli, le style néo-basque revient. Dans les permis de construire, les règlements d’urbanisme, les projets d’aménagement, le rouge des colombages et les toits à deux pentes réapparaissent, comme autant de signes rassurants d’une identité retrouvée.
Mais ce retour ne date pas d’hier.
Le style néo-basque naît dans les dernières décennies du 19ème siècle, s’impose au tournant du 20ème et connaît un essor durable jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Il ne s’agit pas d’un pur vernaculaire, mais d’une construction savante, portée par les architectes, les élites culturelles et une clientèle bourgeoise.
Ce style local
devient vite un langage architectural cohérent, capable d’unifier visuellement un territoire en mutation. Et surtout, de répondre à une demande : celle d’une villégiature ancrée dans un imaginaire régional.
Après 1945, le néo-basque se diffuse massivement. Il quitte le monde des villas pour coloniser les lotissements, se standardise autour d’une grammaire réduite : toiture à double pente, faux pans-de-bois, volets rouges. Une forme de banalisation, mais aussi un succès populaire : ces signes familiers permettent de donner l’impression d’avoir toujours été là
.
Aujourd’hui, le débat se rejoue — dans un contexte de pression foncière et immobilière, de crise du logement, d’attractivité sur puissante du Pays Basque et de la double question qu’elle pose : celle de la capacité d’accueil et de la perpétuation d’une identité, d’un sentiment d’appartenance…
Alors, faut-il aujourd’hui protéger l’harmonie du paysage par des prescriptions formelles ?
Ou, au contraire, éviter de figer le territoire dans une esthétique caricaturale ?
Dans certaines communes, les documents d’urbanisme imposent un code stylistique régional clair. Ailleurs, les références basques sont secondaires, voire absentes.
Entre ces deux extrêmes, une voie intermédiaire ?
Nous en débattrons avec Jacques Battesti, historien, lors de la table ronde Beautés littorales et styles balnéaires : comment faire pour que l’architecture ne gâche pas tout ?