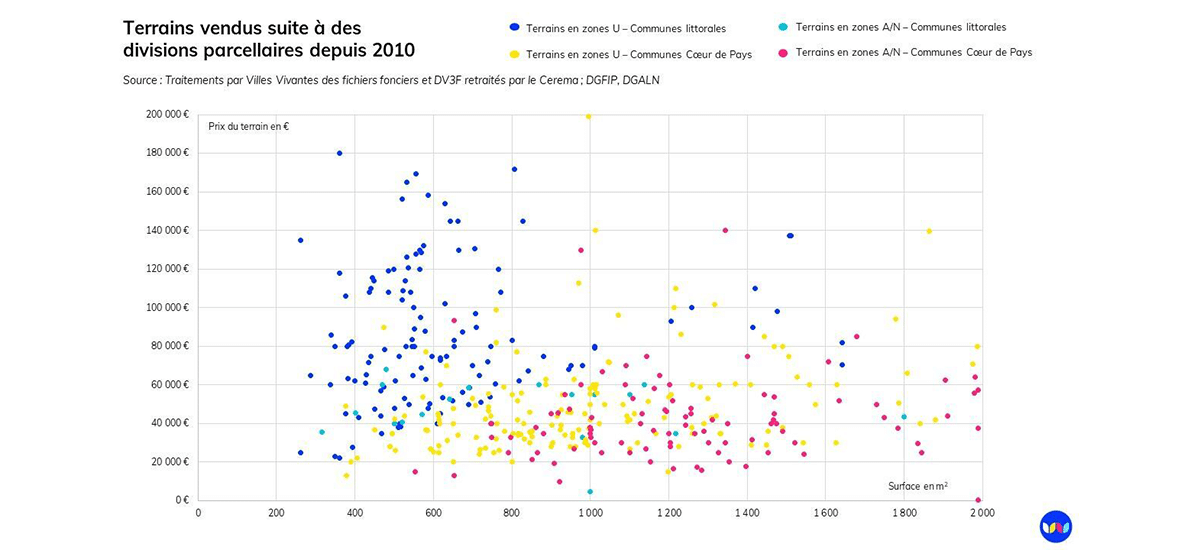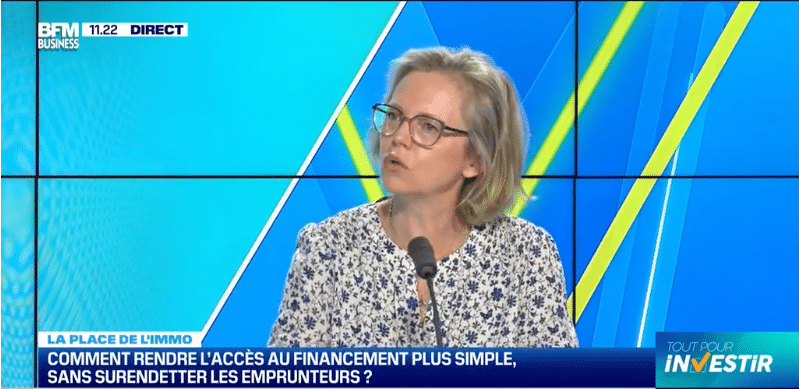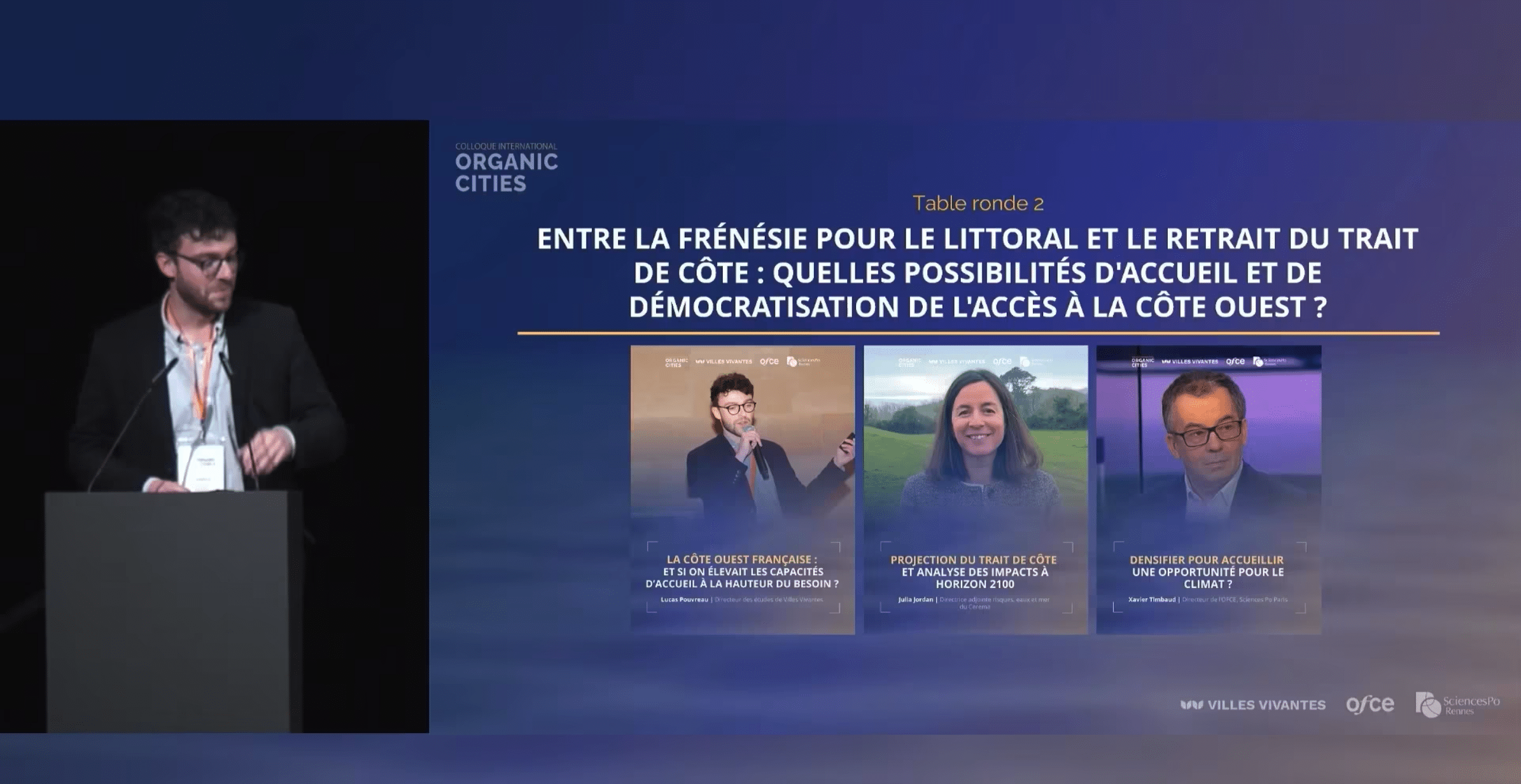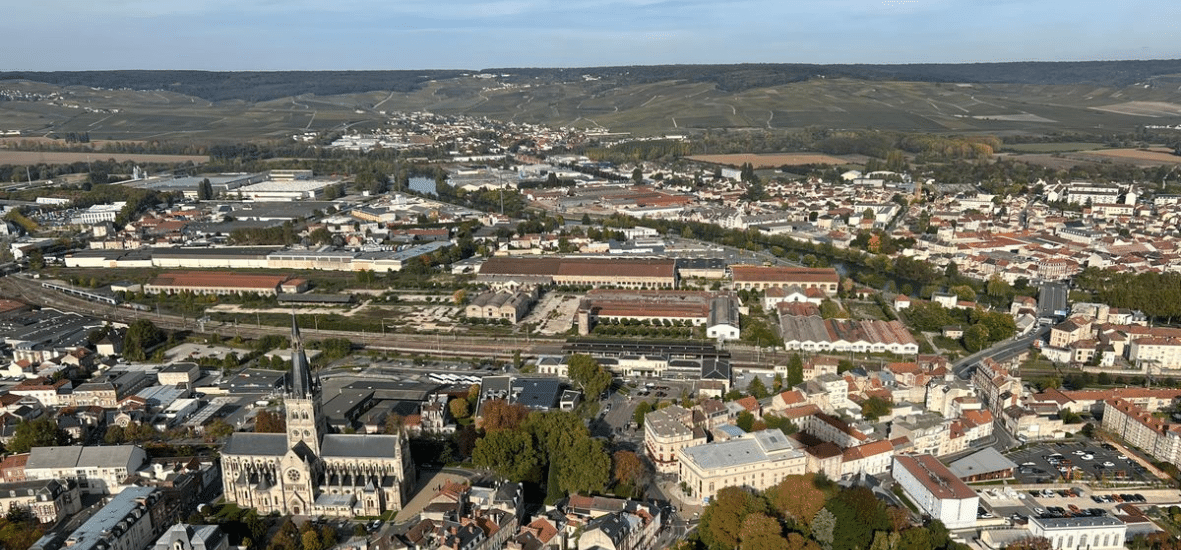Dans la métropole Aix Marseille Provence, la production de logements nouveaux
est-elle vraiment assurée à plus de 60% par autre chose que la construction neuve ?
Non. Pourtant, c’est bien l’interprétation retenue des chiffres produits par l’Institut IDHEAL dans l’étude Du nouveau avec du vieux (novembre 2025), alors que les auteurs prennent soin de formuler d’importantes nuances dans leur conclusion.

Cette interprétation prend le parti :
- D’isoler, au sein du processus de la vacance, les seules sorties de vacance, sans qu’elles soient rapportées aux entrées : à ce rythme, il n’y aurait plus de logements vacants en 6 ans dans toute la métropole. Cette approche conduit à transformer en création nette un processus dont le solde réel est bien plus modeste, voire neutre.
- D’omettre les conclusions de l’étude en ce qui concerne les résidences secondaires, pour lesquelles cet exercice de calcul du solde réel des entrées et sorties est réalisé. Il en ressort seulement 311 résidences principales supplémentaires.
Loin des 6’657 nouveaux logements
comptabilisés à partir des seules sorties de vacance pour l’année 2021, le solde des entrées et sorties est en réalité en défaveur des sorties : entre 2023 et 2024, le nombre de logements vacants depuis au moins 2 ans a augmenté de 1950 unités (source : fichiers fonciers retraités du CEREMA 2023, 2024).
Loin des 12’077 logements évoqués, ces processus de changements d’occupation pourrait ainsi avoir en réalité un impact global négatif sur la capacité d’accueil.
Pour approfondir, voici ci-dessous le détail des explications qui à mon sens, sont nécessaires afin d’éviter des interprétations qui pourraient conduire à sous-estimer l’importance de la production neuve dans la réponse aux besoins.
L’étude se base sur la notion de logements neufs, à laquelle elle oppose la notion de logements nouveaux
.
Ces derniers, pour l’année 2021, comprennent à la fois :
- la production neuve, qui s’élèverait à 8’472 logements,
- les transformations du bâti existant, qui s’élèveraient à 3’543 logements,
- et les changements d’occupation, qui s’élèveraient à 12’077 logements.
L’ampleur des apports liés aux changements est très fortement surestimée.
1. Comme la vacance frictionnelle, la vacance structurelle connaît, elle-aussi, des entrées et des sorties
Le cœur de ma critique est davantage conceptuel : il tient à l’emploi du terme offre nouvelle pour décrire des changements d’occupation qui relèvent en réalité de mouvements internes au parc existant dont l’impact est sans commune mesure avec les chiffres énoncés sur la capacité réelle d’accueil du territoire. Cette offre nouvelle, est loin de constituer une offre supplémentaire.
Les praticiens le savent bien : la vacance observée sur une année comprend une part importante, parfois même majoritaire, de vacance frictionnelle, c’est-à-dire la vacance liée à la rotation normale des ménages dans le parc. Il s’agit des logements en vente, en relocation, en travaux, ou simplement en transition entre deux occupants. Cette vacance n’est pas un dysfonctionnement : elle constitue au contraire une marge de fluidité indispensable. Si aucun logement n’était vacant à un instant donné, aucun mouvement résidentiel ne serait possible. Ainsi, le volume de logements en vacance frictionnelle est relativement stable d’une année à l’autre, oscillant légèrement à la hausse ou à la baisse. En revanche, la composition de l’effectif des logements dans la vacance frictionnelle change en permanence.
Dans la pratique, les études visant à qualifier la vacance, notamment lorsqu’elles s’inscrivent dans une logique de prise de contact avec les propriétaires, isolent généralement la vacance structurelle à partir d’un critère de durée : sont considérés comme vacants structurels les logements inoccupés depuis au moins deux ans. Cette approche, pertinente pour prioriser les situations les plus problématiques ne doit toutefois pas faire oublier que tout logement vacant depuis deux ans a, par définition, été auparavant vacant depuis une seule année auparavant.
Autrement dit, si un logement vacant depuis plus de deux ans présente manifestement une difficulté à revenir sur le marché, l’inverse n’est pas garanti pour les logements vacants depuis seulement un an : une partie d’entre eux alimentera inévitablement le stock des logements vacants depuis deux ans ou plus. Le stock de logements en vacance structurelle, comme la vacance frictionnelle, n’est pas figé ; il connaît des entrées (logements glissant vers une vacance longue) comme des sorties (remise sur le marché, occupation, travaux, démolition).
La vacance structurelle est donc, tout comme la vacance frictionnelle, un phénomène de flux. Son volume global reste le plus souvent stable, avec des variations modérées d’une année à l’autre, tandis que sa composition interne se renouvelle en permanence.
En comparant l’effectif de logements vacants depuis au moins 2 ans entre les fichiers fonciers 2023 et 2024 sur la métropole Aix-Marseille-Provence, ceux-ci passent en un an de 36’370 unités à 38’320 unités, soit une hausse de 1950 logements vacants depuis au moins 2 ans.
2. L’analyse sur une année des changements de résidences secondaires à partir des fichiers fonciers : des biais administratifs importants
Le même problème peut être relevé pour le flux des résidences secondaires devenant résidences principales. L’étude le reconnaît d’ailleurs explicitement : si l’on observe 5’510 sorties
de résidences secondaires considérées isolément, le solde net réel de ce mouvement n’est que de 311 unités. Cela illustre bien que ces flux ne doivent pas être interprétés comme une création nette de capacité d’accueil, mais comme des mouvements internes au parc dont une grande partie s’annule d’elle-même.
S’agissant des résidences secondaires, un risque méthodologique supplémentaire apparaît lorsqu’on analyse ces phénomènes à travers les fichiers fonciers : celui de ne capter qu’un processus administratif, et non un changement d’usage réel. En effet, un bien acquis dans le neuf comme dans l’ancien peut présenter un retard d’actualisation de la nature d’occupation déclarée. Il est fréquent que le passage en résidence principale soit enregistré plusieurs mois, voire plusieurs années en cas de travaux, après l’installation effective du propriétaire occupant.
Par conséquent, une part significative des sorties de résidences secondaires identifiées dans les fichiers pourrait en réalité correspondre à des logements n’ayant jamais été utilisés autrement qu’en résidence principale, au moins par leur propriétaire actuel. Cela invite à interpréter ces données avec prudence : les flux bruts ne reflètent pas toujours des transformations d’usage réelles, mais parfois de simples mises à jour du statut administratif des biens.
Conclusion : l’offre supplémentaire reste majoritairement produite par la construction neuve
L’apport global des changements d’occupation est donc négatif sur le territoire. L’offre supplémentaire reste ainsi délivrée pour 67% par la construction neuve, le reste étant assuré par la transformation du bâti existant.
Il reste fondamental de comprendre que le marché de l’ancien, non seulement existe dans les parcours résidentiels des habitants du territoire, mais en est le fait majoritaire : il y a en effet chaque année davantage de logements investis dans le parc ancien que dans le parc neuf. Néanmoins, le parc ancien compte, dans le même temps, autant de désinvestissements, là où la production neuve ne connaît qu’un seul mouvement : les nouvelles entrées.
Ce sont les logements supplémentaires qui augmentent l’offre et peuvent répondre aux tensions sur le marché du logement. En réduire la portée en relativisant leur effectif par rapport au marché de l’ancien ne fera pas disparaître leur rôle.