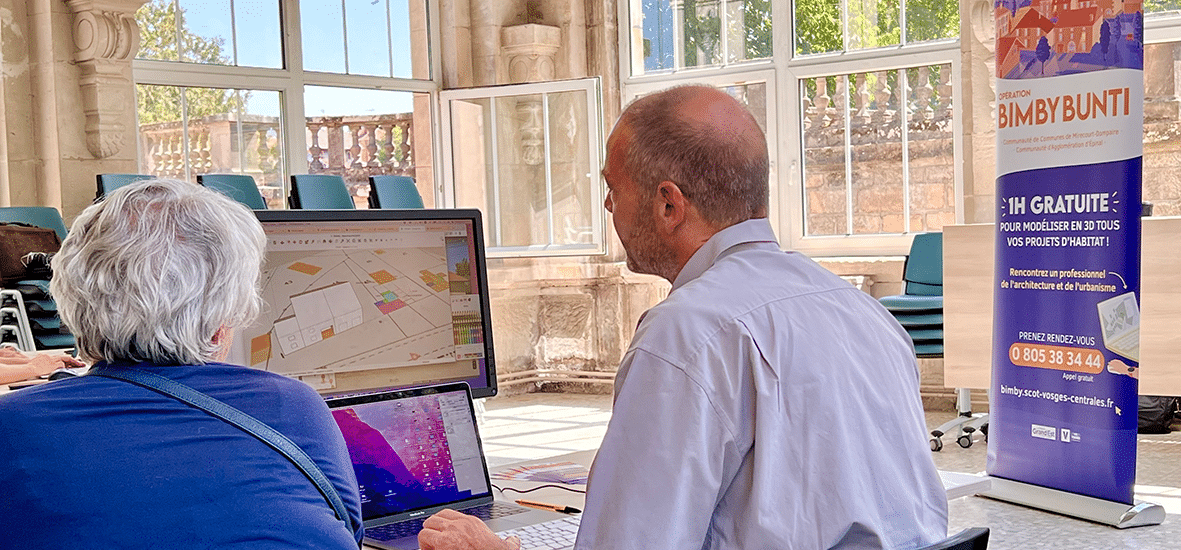En 1807, le Premier Empire impose un plan d’alignement aux villes de plus de 2’000 habitants. Un tracé invisible fixe la limite que les façades ne peuvent dépasser. L’intention est claire : ordonner, moderniser, discipliner l’espace urbain.
Mais une ville ne se laisse pas dompter si facilement…
À Paris, où le tissu médiéval s’accroche encore aux pavés, le préfet Chabrol fait ce constat, désabusé, en 1819 : à ce rythme, il faudra plusieurs siècles pour imposer partout l’alignement ! On voit, encore aujourd’hui, les effets ponctuels de cette tentative : des bâtiments en léger retrait de leurs voisins, vestiges d’un ordonnancement avorté.
Dès les années 1830, l’administration comprend que cette méthode est vaine. Et l’alignement cède sa place à la percée : celle qui rase et reconstruit en force.
Mais l’alignement est resté.
Il façonne nos villes, non plus comme simple outil technique, mais aussi comme recette esthétique… qu’on inscrit, sans trop de conviction, dans la plupart des zones de nos PLU, et que l’on demande ensuite aux juges administratifs d’apprécier — et de trancher — en cas de litige !
Ainsi, le 28 février 2024, la cours administrative d’appel de Paris décidait-elle de confirmer le refus, par le maire de Montreuil, d’une demande de PC sur le fondement que celui-ci ne pouvait se fonder sur l’implantation du projet par rapport à une seule construction voisine et devait prendre en compte l’implantation par rapport à l’ensemble des constructions avoisinantes ; or quasiment tous les bâtiments de la rue étaient implantés à l’alignement
…
A défaut de meilleure boussole, donc, nous avons l’alignement !
Pourtant,
1. Il engendre l’ennui
Il peut structurer une ville avec élégance, mais il peut aussi l’enfermer dans une fade répétition. À Bordeaux, les rues d’échoppes en pierre sont superbes, mais l’œil du flâneur y cherche la rupture, l’imprévu.
2. Son esthétique est fragile
La moindre rupture d’alignement choque comme un faux pas. Mais les villages nous enseignent autre chose : là où l’hétérogénéité règne, l’ajout d’une nouvelle pierre ne rompt pas l’harmonie.
3. Il entrave l’adaptation
D’un côté de la rue, des jardins exposés sud ; de l’autre, ils sont au nord. Et pourtant, la même règle.
4. Il nie les singularités
Certains veulent fleurir le jardinet de devant, quand d’autres rêvent d’un jardin caché. Ceux-là cherchent à se protéger du vent, les autres du soleil. Une ville ne se conçoit pas qu’en lignes droites, mais également en résonance avec ceux qui l’habitent.
L’alignement convient au majestueux.
Pour le quotidien, la liberté est plus opérante.
Ainsi, lorsque nous avons élaboré le PLUi de l’agglomération de La Rochelle, mais aussi le règlement de la BAMBA de Clermont, nous avons choisi une autre voie : celle de l’optionalité
L’optionalité, cette propriété qui nous permet de faire de l’imprévu un atout
 . Dans une même rue, au lieu d’une règle unique, vous avez le choix entre plusieurs options d’implantation.
. Dans une même rue, au lieu d’une règle unique, vous avez le choix entre plusieurs options d’implantation.

Source : Villes Vivantes