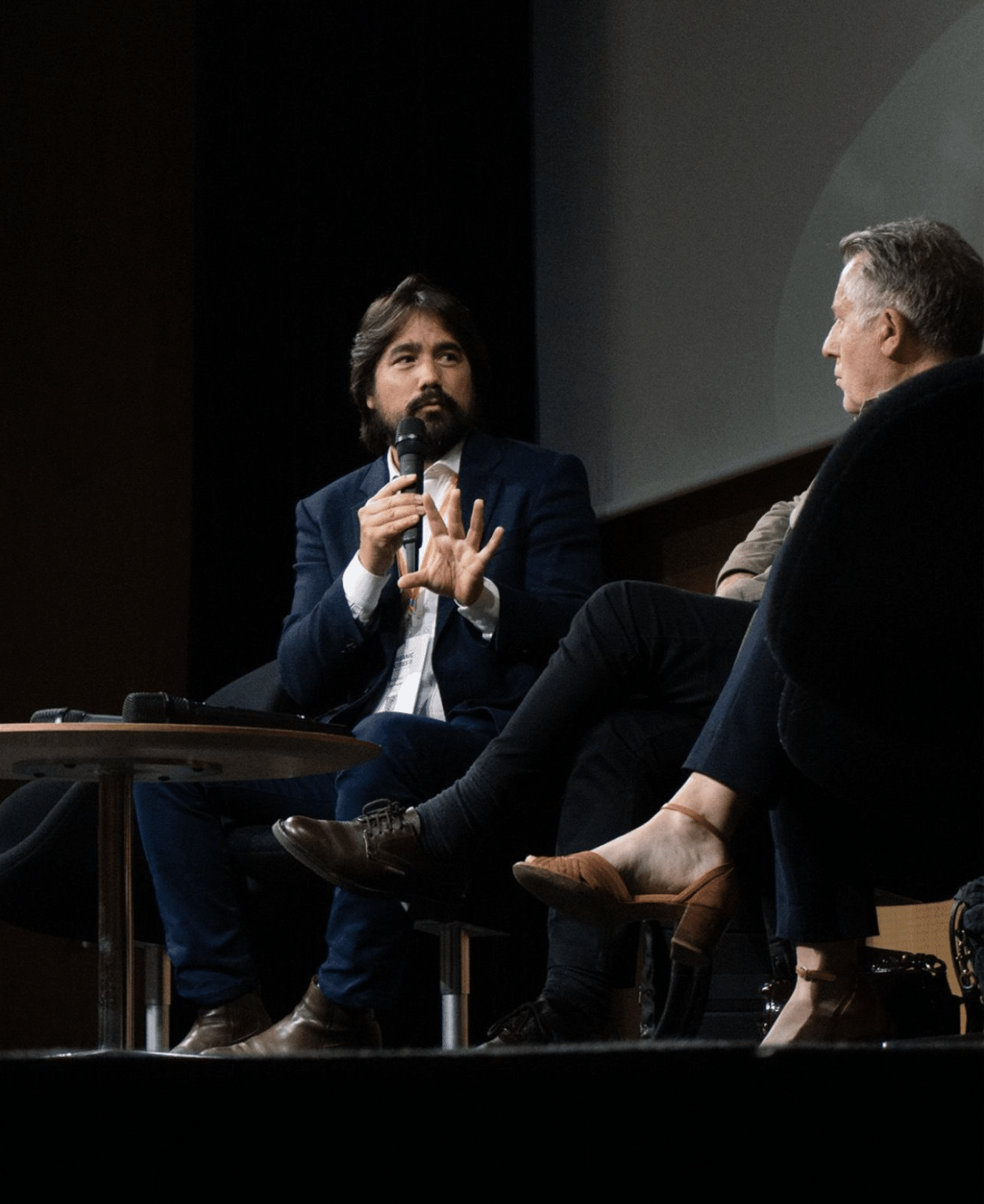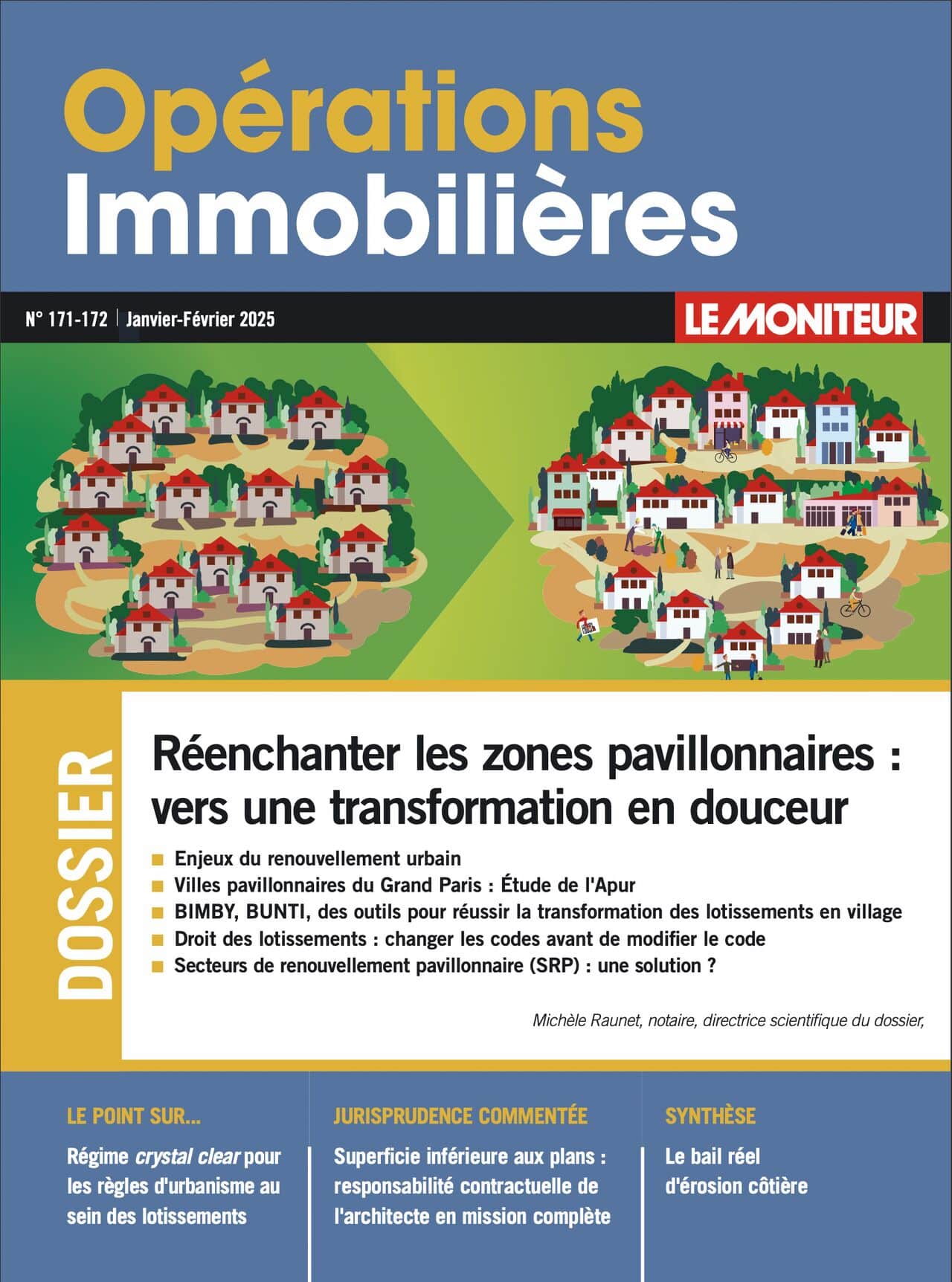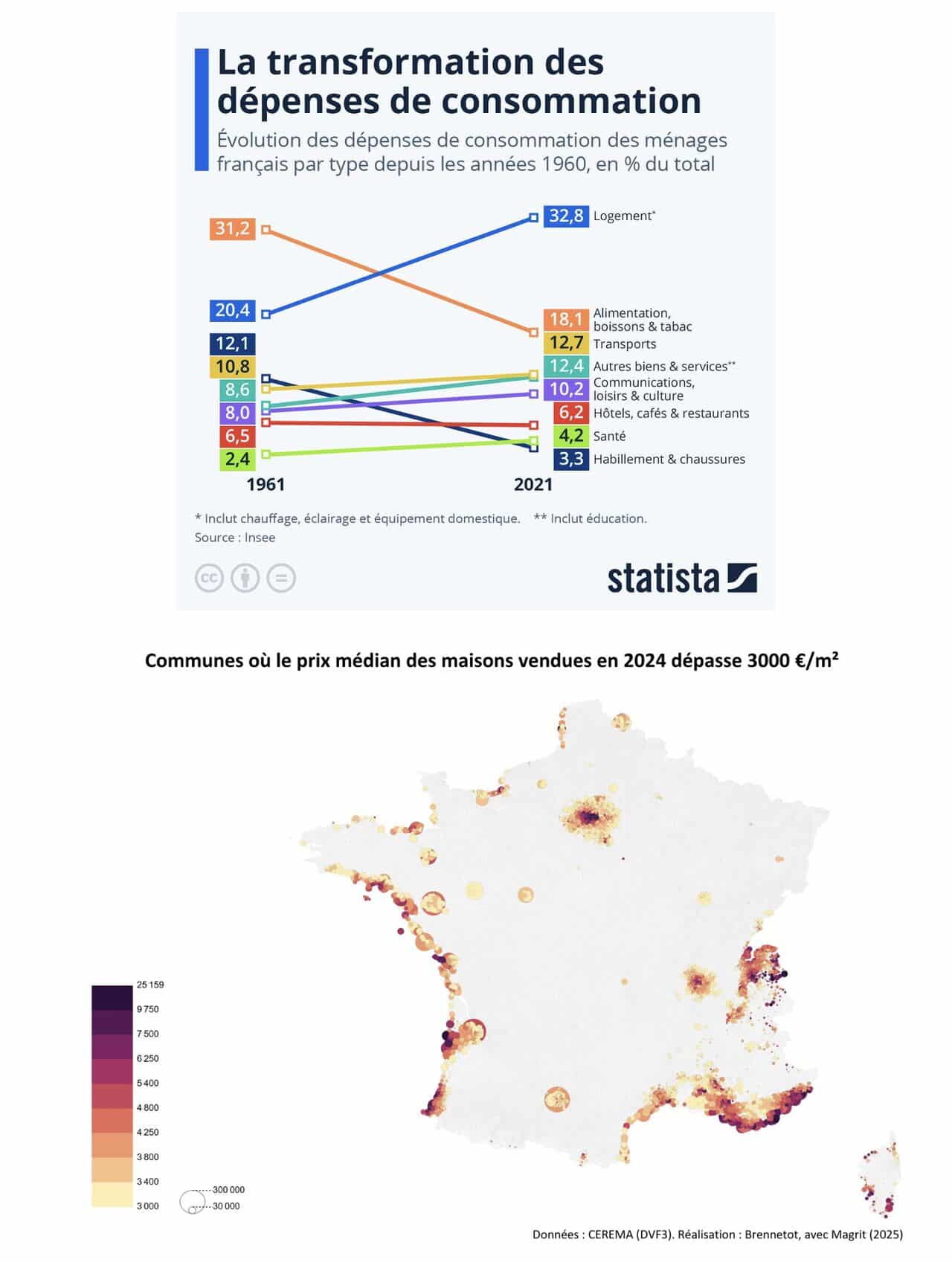La fractalité du bâti, celle de nos maisons, de nos espaces de vie, de nos édifices publics comme privés, se joue à deux niveaux :
1. Celle de la configuration spatiale du bâti, qui produit les espaces reliés les uns aux autres, mais aussi emboités les uns dans les autres, dans lesquels nous vaquons à nos occupations.
Par un processus de conception récursif, sur lequel je reviendrai, les espaces fractals gagnent en cohérence, lisibilité, redondance et superposition, c’est-à-dire en intensité d’usage.
2. Celle de l’ornement qui donne, selon son degré de récursivité et selon la volupté de ses formes, à chaque espace sa tonalité, à chaque paroie sa profondeur, son grain, une façon spéciale de recevoir et de réfléchir la lumière.
Pour nous le décrire plus finement je laisse la parole à Benoît Mendelbrot qui, s’il fut l’un des premiers à mettre les fractales en mots et en formules mathématiques, n’en fut pas pour autant l’inventeur, comme nous pouvons l’observer, simplement, sur ces façades de la médersa Abdoullaziz-Khan, construite à Boukhara (Ouzbékistan) au 17ème siècle.
Les nuages ne sont pas des sphères, les montagnes ne sont pas des cônes, les rivages ne sont pas des arcs de cercle, l’écorce d’un arbre n’est pas lisse et l’éclair ne trace pas de ligne droite.
La nature est complexe et la géométrie fractale rend compte de cette complexité et permet de l’étudier.
Un nuage est constitué de volutes de volutes de volutes qui chacunes ressemblent à des nuages.
A mesure que vous vous rapprochez d’un nuage que vous n’avez pas quelque chose de lisse, mais des irrégularités sur une plus petite échelle.