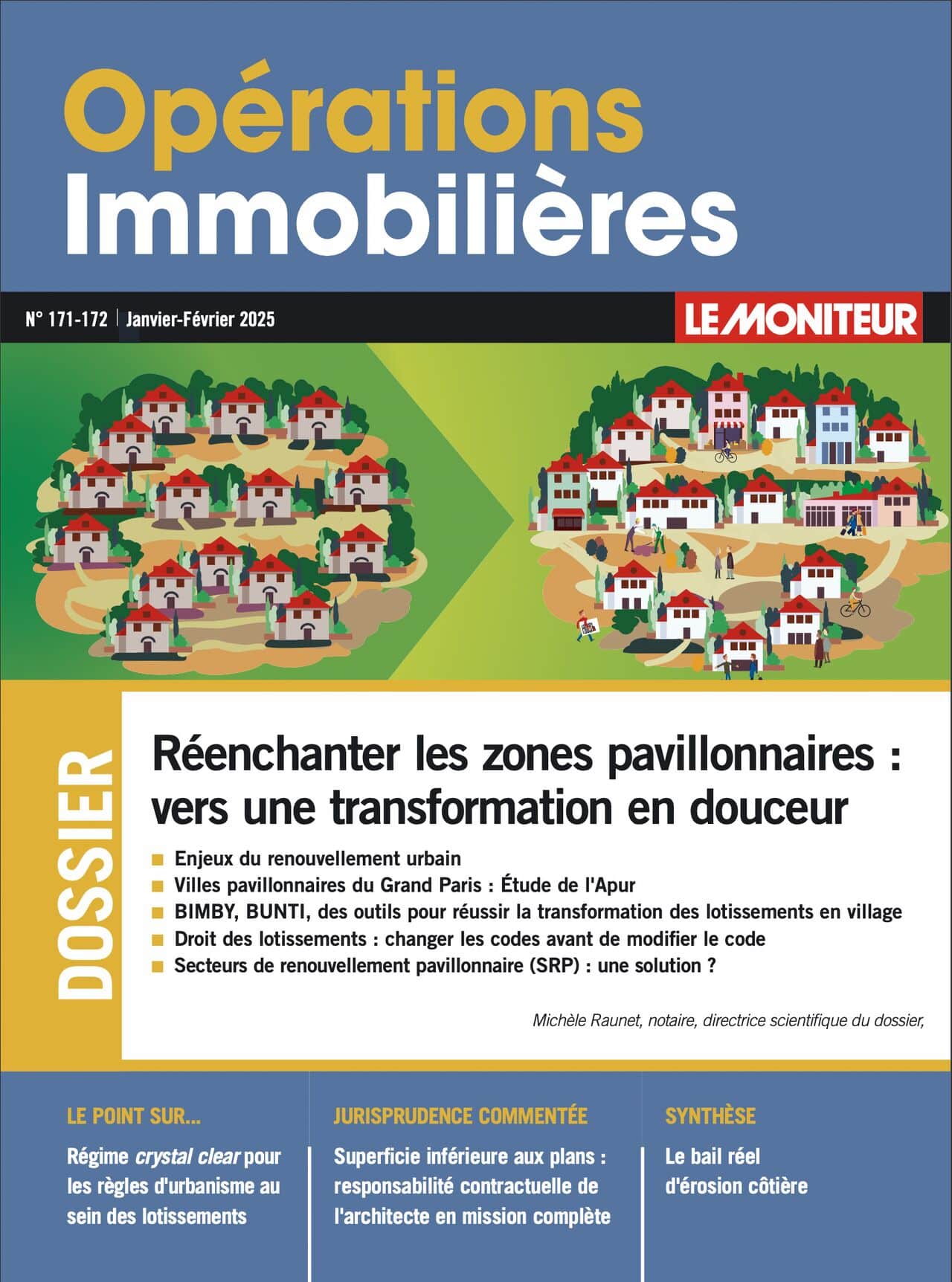L’incrémental peut-il produire du monumental ?
1. Toute une ville sous un seul toit
Il est naturel d’associer à la fine granularité
La fine granularité : clé de l’antifragilité ?
 (des parcelles petites, relativement autonomes les unes vis-à-vis des autres dans leur capacité d’adaptation et d’évolution) l’idée de l’échelle
(des parcelles petites, relativement autonomes les unes vis-à-vis des autres dans leur capacité d’adaptation et d’évolution) l’idée de l’échelle humaine
: celle de la maison, du foyer ou de l’entreprise familiale.
Elle évoque l’ajustement, la proximité, le sur-mesure, mais rarement la monumentalité.
Et pourtant, lorsque notre regard croise la grande façade occidentale de Notre Dame de Paris, une vue aérienne de Manhattan, ou encore ce plan organique du Grand Bazar d’Istanbul, nous percevons une forme de grandeur d’autant plus puissante qu’elle est presque sans geste
.
Fondé en 1455 sous le règne de Mehmet II, agrandi pendant des siècles, sans plan directeur, le Grand Bazar a évolué comme un organisme vivant : reconstruit après des incendies, consolidé après des séismes, il s’est étendu par ajouts successifs, échoppe par échoppe, jusqu’à former une ville dans la ville
.
Et si la clé de l’adaptabilité d’une ville était… le village ?

Avec ses 4’000 boutiques, ses 60 rues intérieures, ses multiples strates historiques, il constitue l’un des plus grands ensembles commerciaux au monde. Et pourtant, il n’est le fruit ni d’un plan d’ensemble, ni d’un geste unique.
Il est né — et continue d’évoluer — par agrégation de cellules élémentaires : échoppes, allées, patios, des modules répétables et adaptables dont l’accumulation ordonnée nous rappelle cette vérité un temps oubliée par l’urbanisme moderne : la monumentalité organique, celle de la voie, de l’avenue ou de la simple allée du marché, ne repose pas tant sur la grandeur isolée de chaque objet urbain que sur la force et l’intensité de leurs relations.
2. La fine granularité ne produit
pas le grandiose de façon immédiate
Elle en rend possible l’émergence. Elle autorise la croissance, l’appropriation, la transformation — avec cette souplesse remarquable qui tient dans le fait qu’elle n’exige pas la synchronisation des initiatives, ni la préexistence d’un plan finalisé. Elle substitue à la vision totalisante un système d’auto-organisation, dont les résultats échappent souvent à la prédiction, mais rarement à la beauté
Quand la beauté d’une ville vient autant du dessin que du grain
 .
.
3. Ce que nous appelons grandeur
pourrait donc changer de sens
Laissons les concours de hauteur, les gestes et gabarits démesurés, les symétries qui ne sont parfaites que lorsqu’elles sont vues du ciel.
Et travaillons la densité
Le consensus sur l’urbanisme dense est à reconstruire
 d’usages, la complexité vécue, la profondeur historique, la puissance d’évocation.
d’usages, la complexité vécue, la profondeur historique, la puissance d’évocation.
Le grandiose non pas comme projet, mais comme émergence.
Et si l’avenir de la grandeur de nos villes ne résidait pas dans le gigantisme des formes, mais dans la fertilité du grain ?