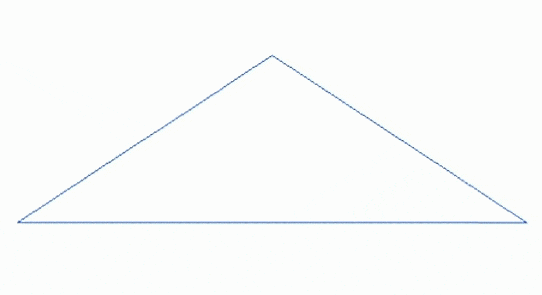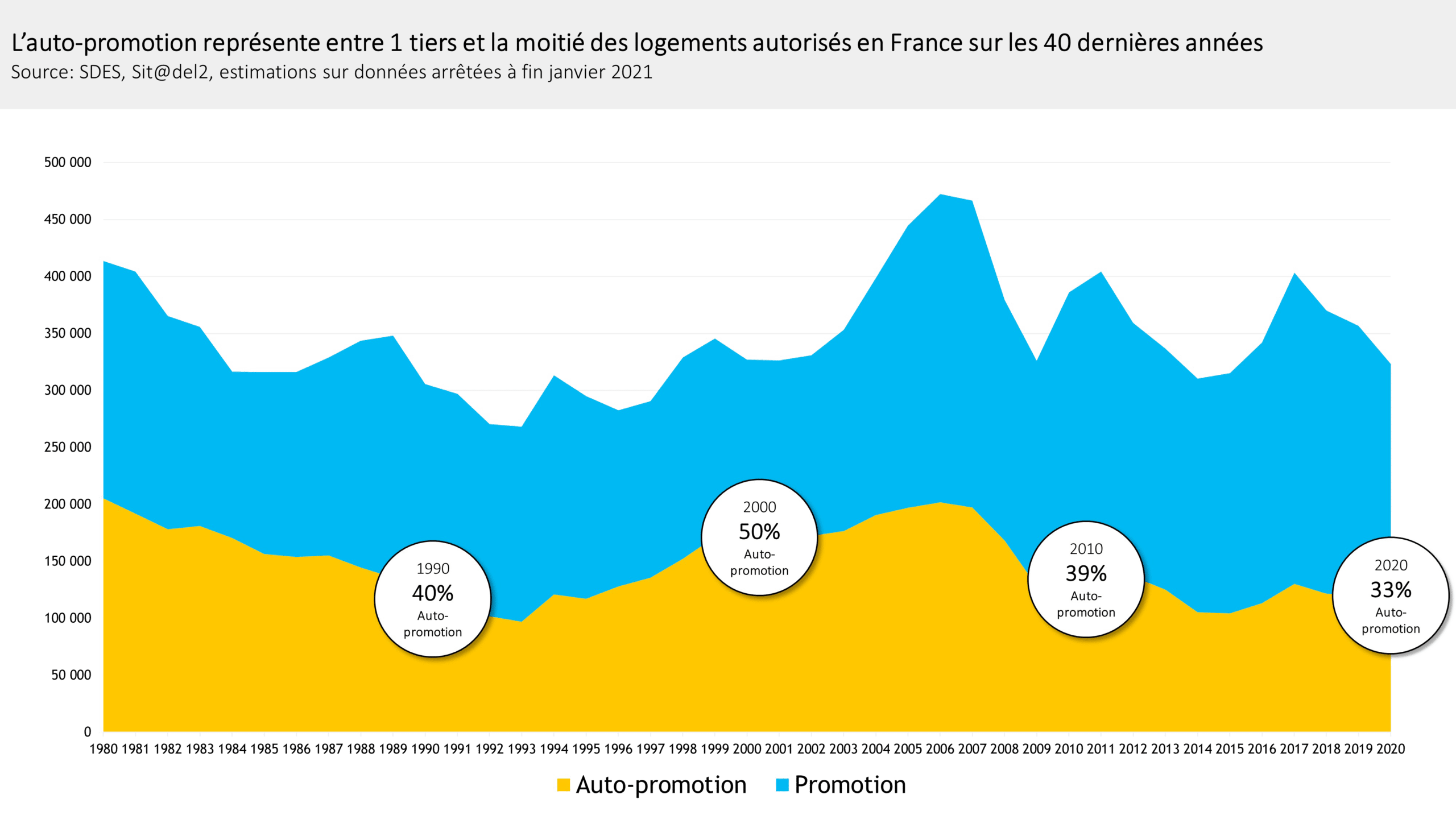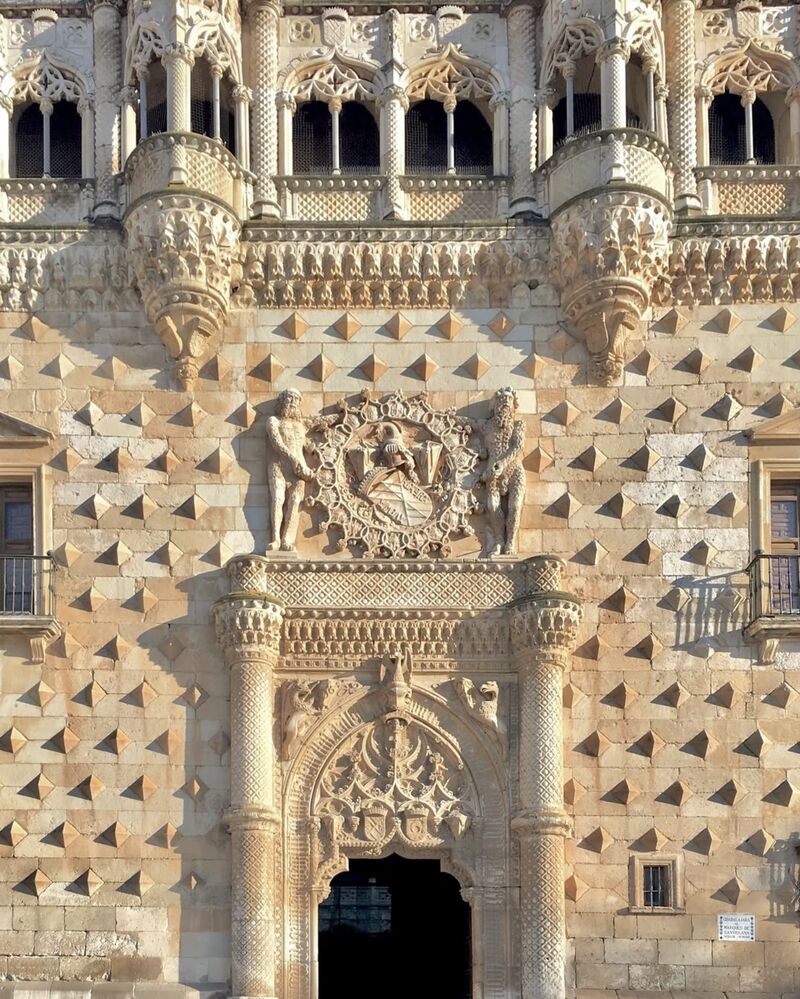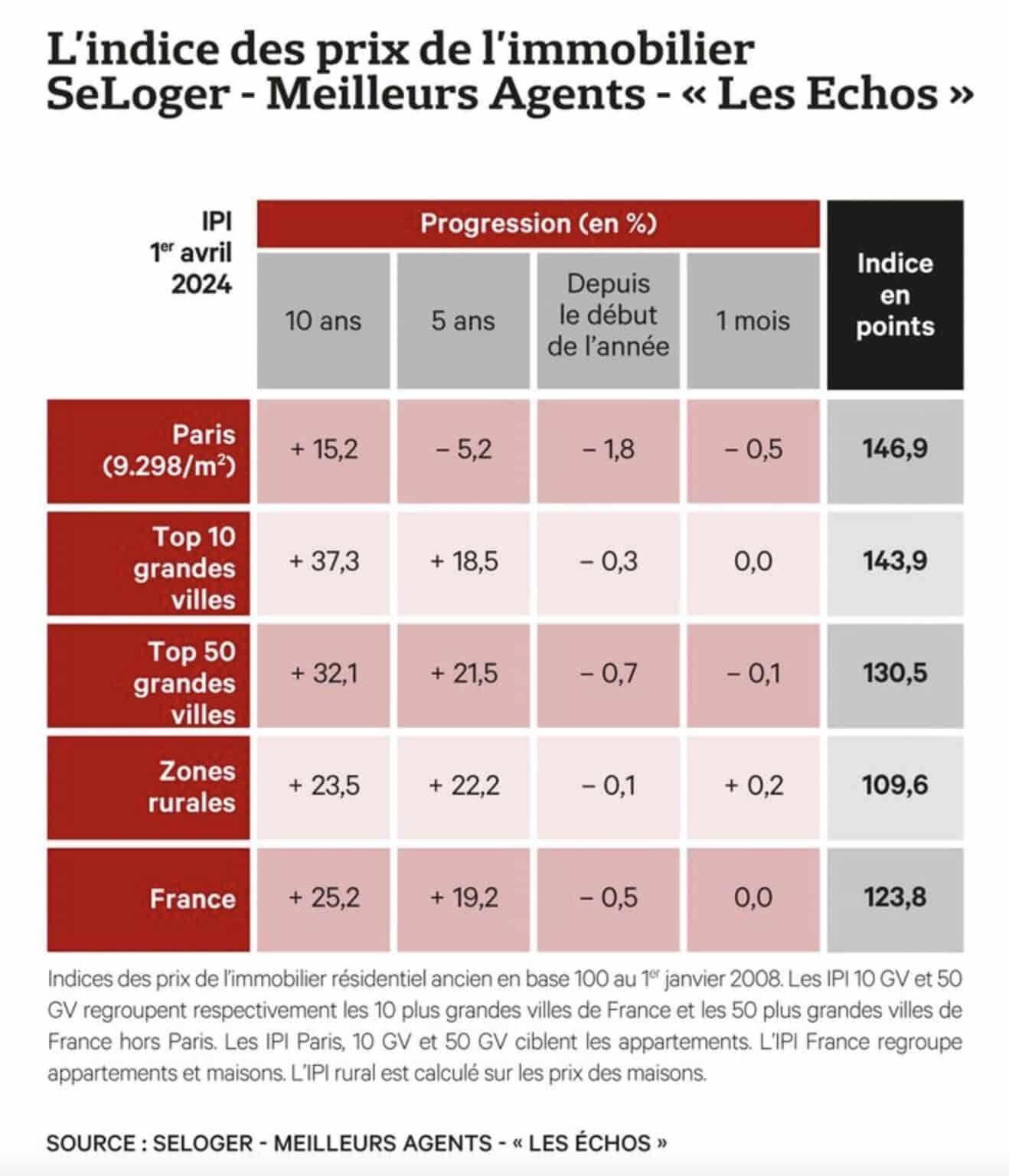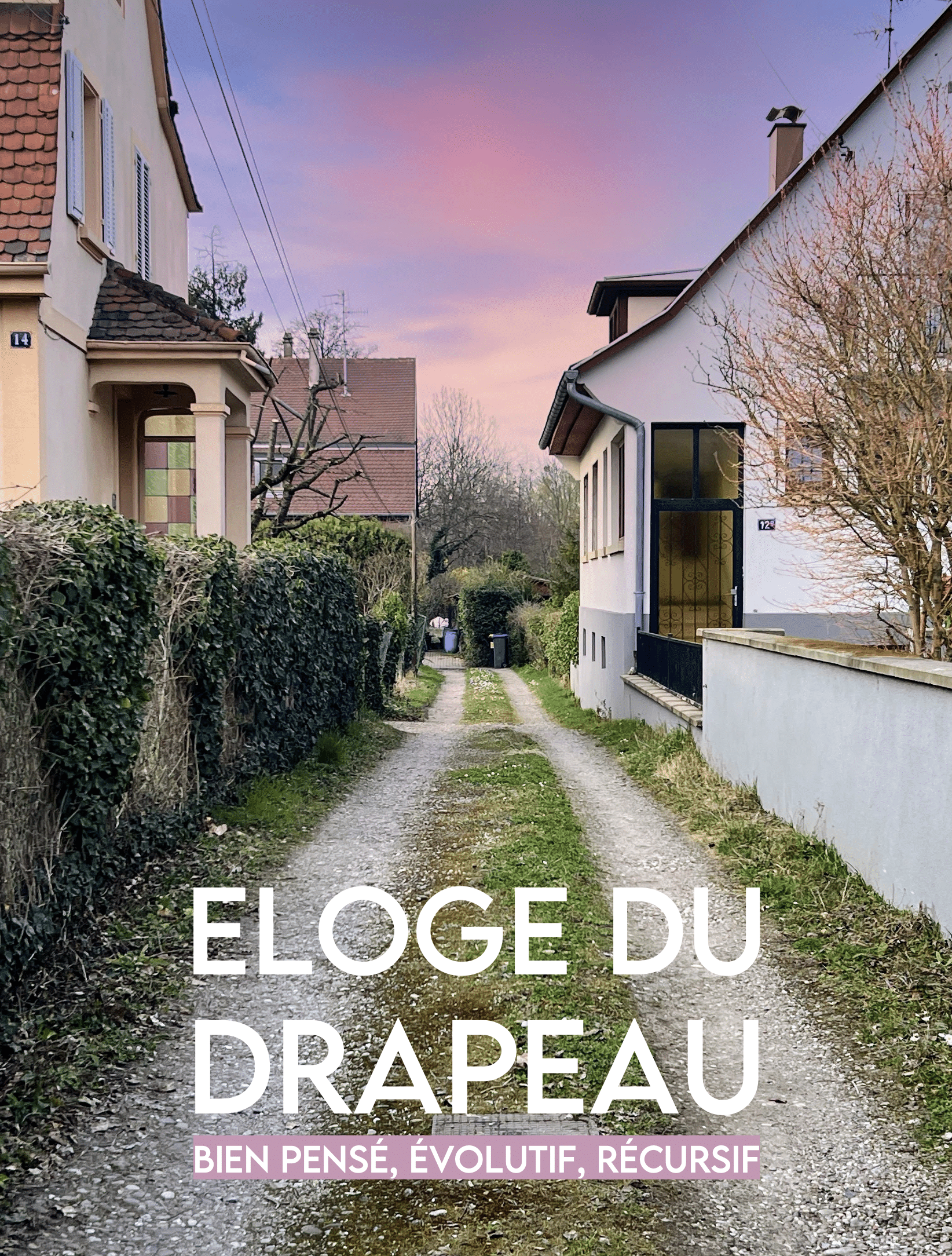La densification douce : nouvel étendard des solutions à la crise du logement ?
« Il faut cette densification douce« , prône mardi 19 mars sur France Inter le directeur des études de la Fondation Abbé Pierre (FAP), Manuel Domergue, qui a produit un rapport avec la Fondation pour la Nature et l’Homme intitulé « Réussir le ZAN en réduisant le mal logement, c’est possible ».
C’est une évidence : malgré l’importance de son potentiel, et toutes les annonces dont elle fait l’objet ces dernières semaines, la densification douce ne résoudra pas tous les problèmes de la crise du logement à elle seule.
Ce qui est intéressant à noter, par contre, dans les récentes prises de parole du 1er Ministre et du Ministre du Logement
Le gouvernement en passe de faire de la maison et de la densification douce l’un des piliers de sa politique du logement
 , mais également de ces 2 fondations, c’est qu’elles font de la « densification douce » l’un des nouveaux « étendards » pour présenter, au grand public, toute la palette des solutions à la crise du logement.
, mais également de ces 2 fondations, c’est qu’elles font de la « densification douce » l’un des nouveaux « étendards » pour présenter, au grand public, toute la palette des solutions à la crise du logement.
Pourquoi ?
Parce que le problème que nous rencontrons tous, sur le terrain, si l’on souhaite préserver les terres naturelles et agricoles et continuer à accueillir, c’est tout simplement, à côté de la question des coûts du foncier et de la production du logement, celui de l’acceptabilité sociale des nouvelles constructions en secteur déjà urbanisé, et donc habité, c’est-à-dire l’acceptabilité sociale de la densification.
Densification douce : la solution pour rendre la densité acceptable ?
Non pas l’acceptabilité de ceux qui partagent leur jardin, ou mettent à disposition leur toit pour une surélévation, mais celle des riverains, des voisins, et de l’opinion publique en général.
Pour aller encore plus loin, faudra-t-il abandonner, à terme, le terme même de « densification » ?
Comme l’explique la Fondation Abbé Pierre, « la densification douce, qu’elle soit verticale ou horizontale, n’aboutit pas à des grandes constructions très impressionnantes » et « ne change pas fondamentalement le visage de la ville, mais ça permet d’habiter un peu plus nombreux ».
A une vitesse de 1%/an en « densification douce » en effet, un quartier dont la densité initiale est de 17 lgts/ha (des maisons individuelles avec des parcelles de 500m2) atteint au bout de 10 ans une densité de, seulement, 19 lgts/ha.
Une différence presque imperceptible.
Et pourtant, cette vitesse de 1%/an est, dans la plupart des territoires, suffisante pour répondre aux besoins.
Passer de 17 à 19 logements à l’hectare n’est pas à proprement parler une « densification », même douce. Mais simplement une démultiplication des possibilités d’accueil, sans que la ville n’ait à s’agrandir.
La « densification douce » n’est pas qu’un concept de communication, bien entendu. Elle a mille vertus économiques, techniques et sociales que j’ai pu contribué à décrire par ailleurs.
Mais s’engager de façon plus sereine dans le débat public sur nos capacités et nos volontés d’accueil est en train de devenir la première marche à gravir pour résoudre la crise du logement.