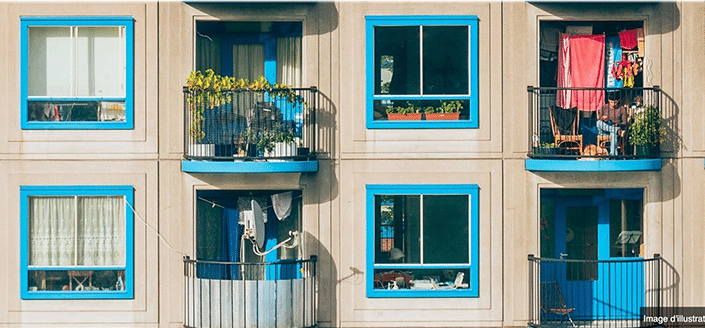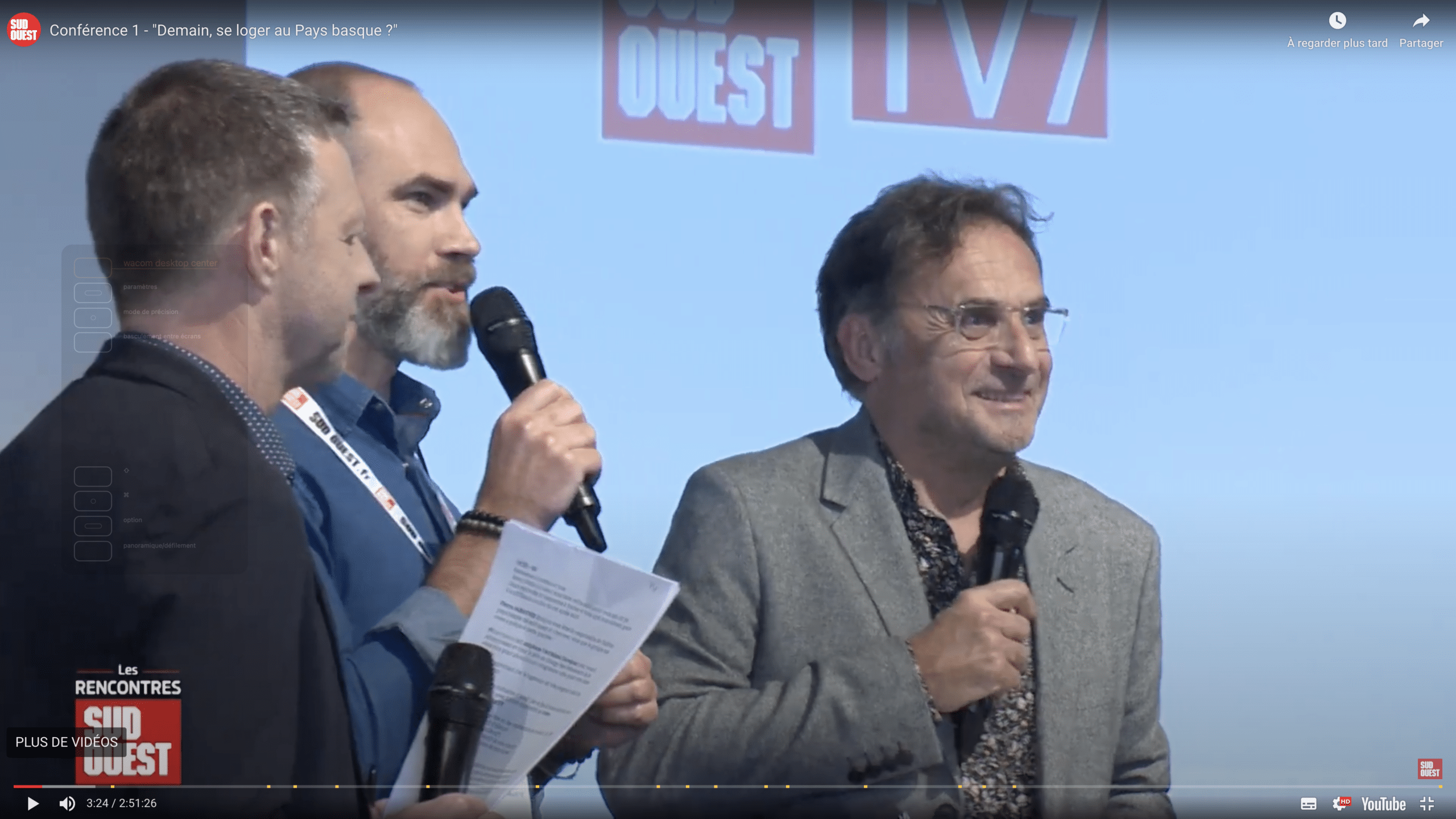Il ne s’agit pas d’un miracle…
Mais d’un procédé de conception.
L’incrémentalité

 est un mode de production progressive du tissu urbain, fondé sur la granularité fine, l’optionalité ouverte
est un mode de production progressive du tissu urbain, fondé sur la granularité fine, l’optionalité ouverte

 et l’adaptation locale des projets
et l’adaptation locale des projets

 , étape par étape.
, étape par étape.
Mais une autre notion, plus structurante encore, mérite d’être explorée : la récursivité.
Elle ne désigne pas une simple addition de projets mais une logique dans laquelle chaque transformation restructure le cadre dans lequel la suivante interviendra.
1. Trois régimes de production urbaine
- La duplication répète un modèle à l’identique, en plus ou moins grand nombre,
- L’incrémentalité additionne les projets les uns aux autres, parcelle par parcelle, de façon libre, désynchronisée, autonome et sur mesure, en suivant des règles communes tout en s’adaptant aux variations du contexte ,
- La récursivité, elle, crée un lien actif entre chaque projet et les précédents qui dépasse la simple notion d’adaptation : ce qui est construit crée de nouvelles conditions qui structureront les options possibles pour les constructions suivantes.
2. Le contexte n’est pas donné, il est construit et il structure les possibles
Sur l’image de présentation de cet article on peut voir :
- À gauche : un lotissement standardisé, à Dubaï,
- À droite : une ville croate façonnée par ajustements successifs, non seulement incrémentaux mais également récursifs : chaque construction y répond à une configuration issue des précédentes.
Et chacune modifie à son tour l’espace d’accueil des constructions suivantes.
Ce n’est pas de l’improvisation, bien que cela y ressemble : les règles semblent avoir évolué en cours de route, mais en fait, c’est le contexte qui a changé et qui a été pris en compte, au sens fort, à chaque étape.
3. La ville comme suite récurrente
Une suite récurrente, en mathématiques, est une suite où chaque terme dépend des précédents : impossible de calculer le dixième terme sans avoir calculé un à un les neuf premiers.
Il en va de même ici : chaque projet est conçu à partir de la situation engendrée par les précédents.
Le concepteur ne travaille pas seulement en autonomie, à partir de règles communes. Il tient compte d’un contexte transformé — qu’il transforme à son tour.
La conception est récursive lorsqu’à chaque étape elle intègre comme nouveau contexte l’ensemble produit à l’étape précédente.
4. Deux modèles de conception de la ville s’opposent
La conception globale fixe un dessin d’ensemble d’emblée.
Celui-ci peut être réalisé d’un coup ou de façon incrémentale, mais il offre assez peu de marges pour évoluer et s’adapter.
La conception récursive, quant à elle, procède — plus radicalement encore que la conception incrémentale — projet après projet.
Elle transforme — en cherchant à chaque étape une cohérence d’ensemble nouvelle : une cohérence plus puissante, qui ne peut pas être dessinée à priori.