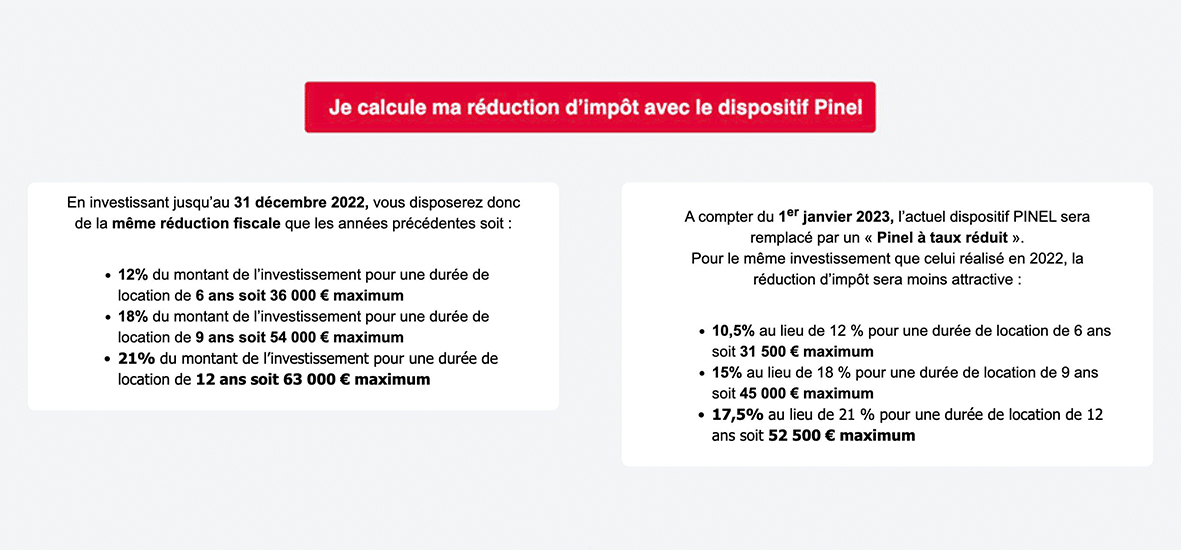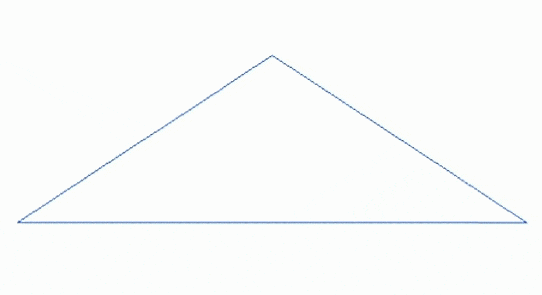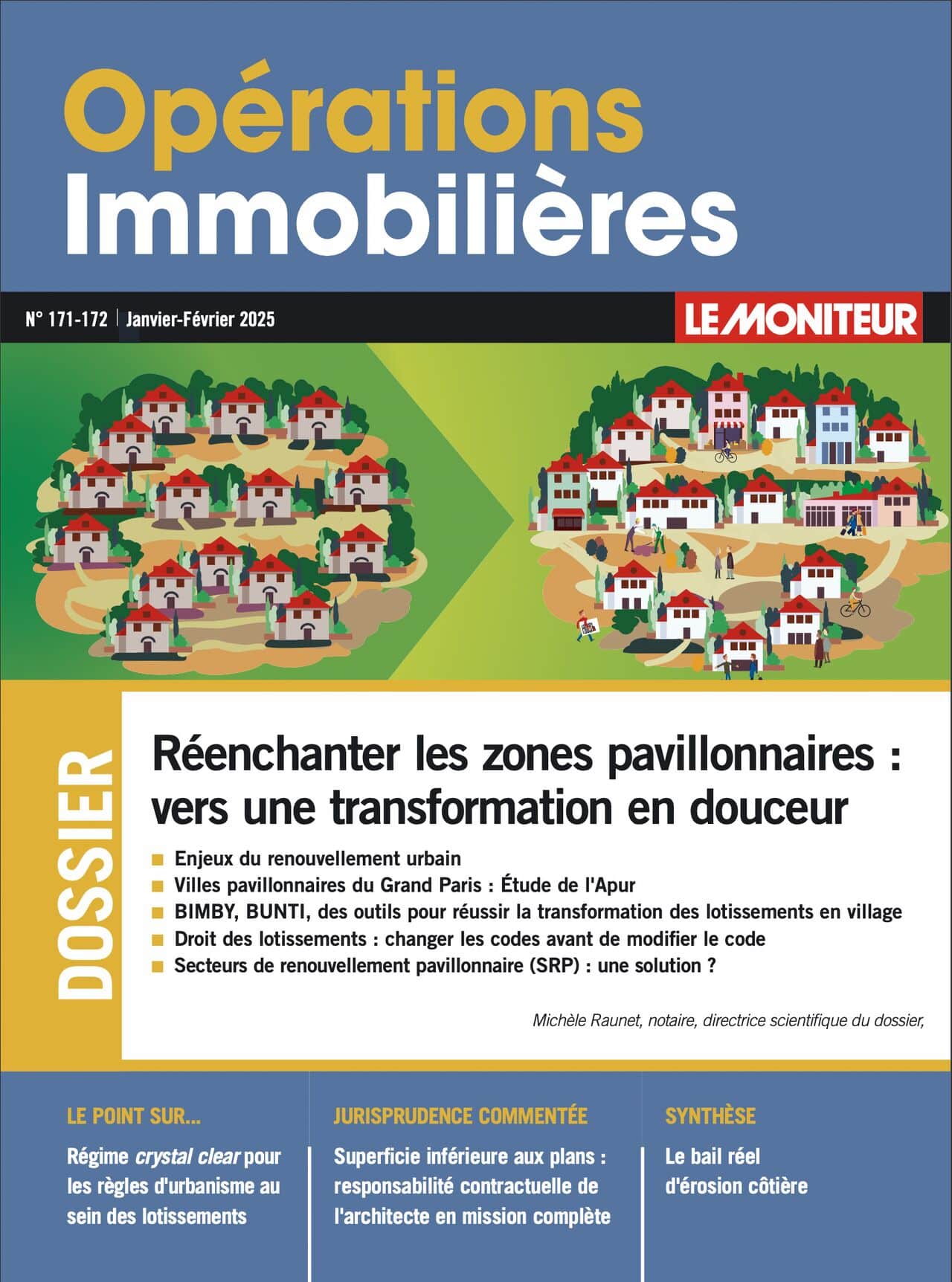Ne seraient-elles pas plutôt le résultat de l’application de dispositifs intelligents, de modèles sophistiqués, de règles subtiles, de patterns mnémotechniques et de méthodes pointues que l’on serait en droit de qualifier, humblement, de high tech
?
Produire du froid gratuit
, ventiler naturellement
Comment l’urbanisme permettait-il de se protéger du vent ?
 , faire baisser les températures
, faire baisser les températures
Cours intérieures : une technique traditionnelle de climatisation passive des villes… qui révèle les limites de nos modèles de simulation du climat urbain
 réelles et ressenties, sans énergie, avec élégance, par exemple, n’est pas donné à tout le monde, et loin d’être simple à réaliser !
réelles et ressenties, sans énergie, avec élégance, par exemple, n’est pas donné à tout le monde, et loin d’être simple à réaliser !
Alors, est-ce vraiment low tech
?
Pourquoi n’arrive-t-on plus à faire ce que l’on réussissait il y a un siècle ?
Le niveau de connaissances s’est effondré de façon parfaitement parallèle à la disponibilité du pétrole au 20ème siècle
C’est par cette formule volontairement provocante que Marc Muller, fondateur d’Impact Living, commence l’un de ses posts Linkedin. Il y pointe du doigt le fait que pendant 2’000 ans, les bâtiments étaient conçus de manière à résister à la chaleur – art qui s’est vraisemblablement perdu au 20ème siècle.
C’est vrai, l’énergie peu chère nous a permis de nous passer d’intelligence et de recourir à des palliatifs simplistes (la climatisation, par exemple) : des palliatifs low tech
Nos villes deviendront-elles plus « durables » grâce à une approche « low tech » ?
 finalement.
finalement.
J’ajouterais que le niveau des connaissances s’est également effondré de façon parfaitement parallèle :
- à l’avènement, dans le champ de l’architecture et de l’urbanisme, de l’idéologie de la
tabula rasa
: on a souhaité raser le coeur de Paris comme on a souhaité éliminer, grâce au tout béton notamment, les métiers, les corps d’état, l’artisanat, les savoir-faire, les modèles architecturaux et urbains, l’art de bâtir les villes… - à l’ultra-découpage des sciences et des techniques, lequel a abouti à ce qu’un bâtiment ou une ville ne puisse plus être compris – ni modélisé – de façon
systémique
, globale, intelligente.
Les modélisations sectorielles – scientifiques
au sens moderne du terme – des ingénieries et des sciences humaines et sociales ont supplanté les modèles architecturaux et urbains historiques, dans l’enseignement, et dans la pratique.
Et si les urbanistes et architectes s’inspiraient des design patterns
?
Rien n’est perdu pour autant, nous pouvons (en nous pressant un peu !) :
- considérer les villes anciennes comme un réservoir de connaissances
Le grand livre des villes vivantes : « tout est déjà là »
 , un état de l’art qui ne demande qu’à être mobilisé ;
, un état de l’art qui ne demande qu’à être mobilisé ; - les modéliser, avec une méthode de modélisation qui ne procède pas au découpage des objets aspect par aspect, facette par facette, mais qui fasse ressortir l’intelligence multidimensionnelle des dispositifs architecturaux et urbains dont nous pouvons aujourd’hui constater les performances : une méthode de modélisation
architecturale
1.
Le travail de Christopher Alexander et son équipe du Pattern Language
2 dans les années 70 est pionnier en la matière.
Pendant plusieurs décennies, le monde des développeurs logiciels s’est très largement approprié cette méthode des design patterns
pour formaliser, partager, faire évoluer les connaissances naissantes de la discipline, des connaissances utiles dans la résolution de problèmes de conception complexes.
En urbanisme et en architecture, ce travail
Bâtir des villes et villages vivants ne se fera pas sans prouesse, sans travail, sans intelligence
 , à l’époque moderne, n’a quasiment pas commencé…
, à l’époque moderne, n’a quasiment pas commencé…
Alors il est peut-être temps de l’entamer !
Notes :
- David Miet. Une épistémologie de la modélisation architecturale. Architecture, aménagement de l’espace. Ecole doctorale ED 355 « Espaces, Cultures et Sociétés », 2013. Français. ⟨NNT : ⟩. https://hal.science/tel-02362492
- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa et Murray Silverstein. A Pattern Language : Towns, Buildings, Construction. New York : Oxford University Press, 1977.